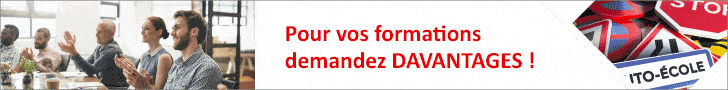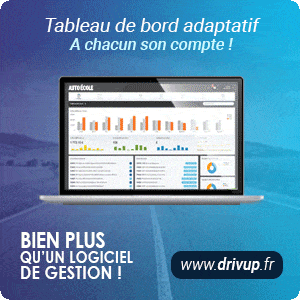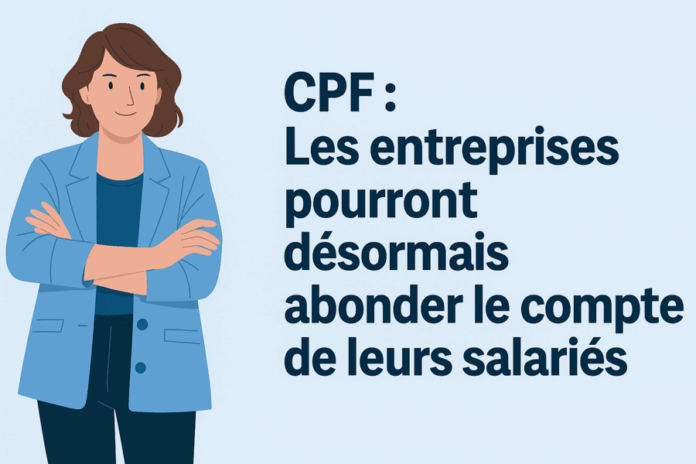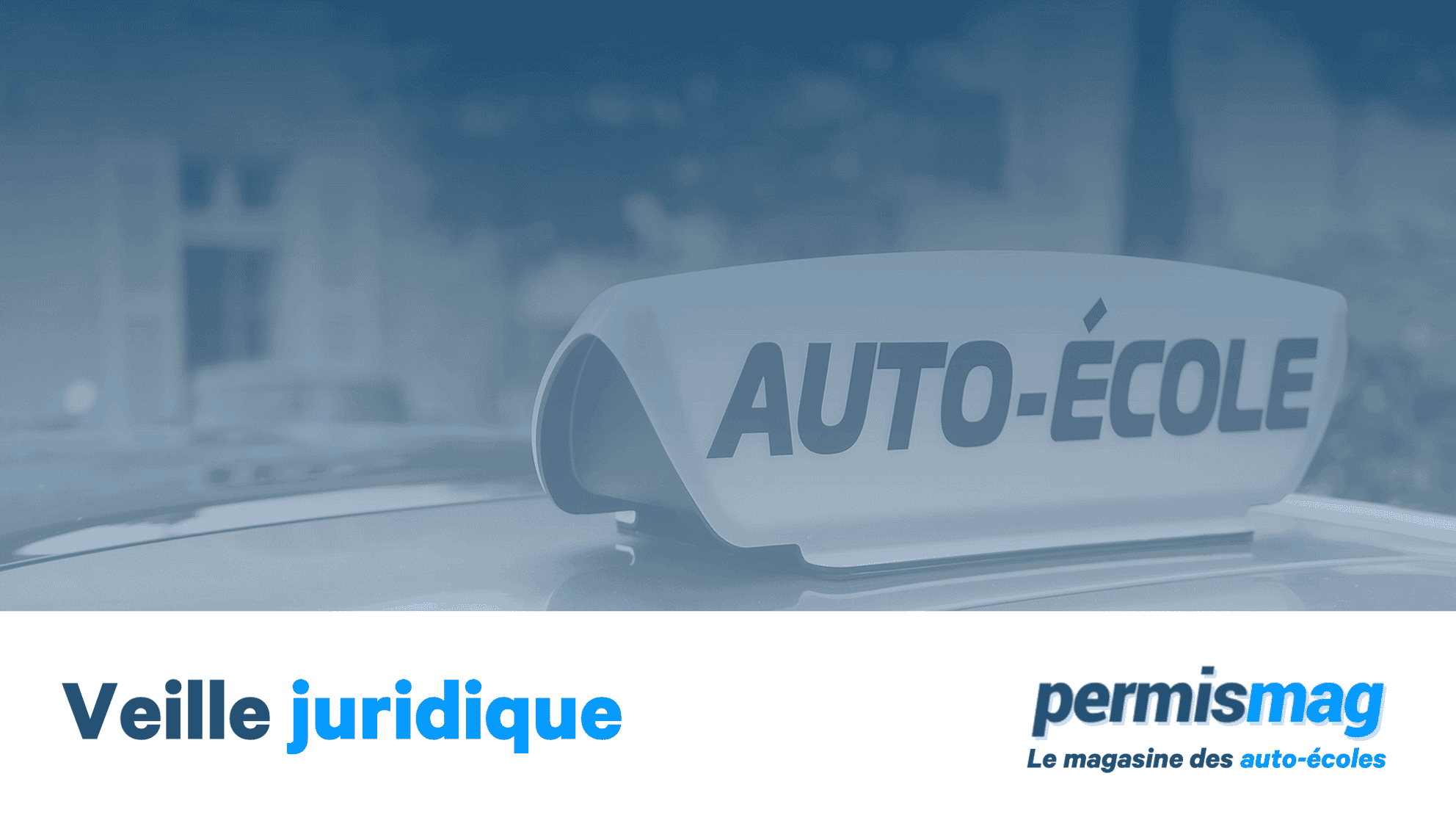La semaine dernière l’UNIC élisait Benjamin Panis à sa tête. Il succède ainsi à Sandra Carrasco. Il a accordé un entretien à PermisMag dans lequel il détaille son programme et appelle les écoles de conduite à rejoindre l’organisation professionnelle.
[PermisMag] Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
[Benjamin Panis] Oui, bien sûr, Benjamin Panis, gérant d’une école de conduite dans le Gard (30), plus précisément à Bessèges, dans les Cévennes. Je suis le seul enseignant de mon établissement, secondé par une secrétaire. J’ai repris cette entreprise dans mon village de 3 000 habitants en avril 2013, après avoir enseigné pendant 3 ans dans plusieurs écoles de conduite.
À quand remonte votre engagement à l’UNIC et qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre cette organisation professionnelle ?
Mon engagement à l’UNIC remonte à fin 2013. Dans le contexte tendu du manque de place de cette année, je souhaitais organiser une manifestation avec mes collègues et j’ai cherché des informations auprès des organisations professionnelles. La première à me répondre fut l’UNIC par la voix de Philippe Colombani. J’ai beaucoup apprécié son approche et ses conseils. Naturellement, suite à cette première action, j’adhère à l’UNIC. Quelques temps plus tard, je suis nommé délégué adjoint pour le département du Gard et, puis délégué départemental. Ce qui m’a encouragé à m’engager avec l’UNIC, c’est la proximité et l’accessibilité de ses dirigeants de l’époque. Il est certain que Philippe Colombani a fortement influencé mon choix à ce moment-là.
Lors de votre prise de fonction, vous avez remercié Philippe Colombani, Sandra Carasco et les adhérents de l’UNIC. Vous comptez vous inscrire dans la continuité de vos prédécesseurs ?
Oui, j’ai remercié d’abord Philippe Colombani, car sans cet appel et les échanges qui ont suivi, je ne me serais peut-être pas syndiqué. Je le remercie aussi pour la confiance qu’il m’a accordé et les conseils qu’il a pu me donner tout au long de ces années. Sandra Carasco, à qui je succède, je ne peux que la remercier chaleureusement, car durant ces trois années où je l’ai secondé comme secrétaire général de l’UNIC, nous avons travaillé ensemble sur de nombreux dossiers. Elle m’a fait confiance pour représenter notre organisation professionnelle dans de nombreuses réunions à la DSR ainsi que dans l’accompagnement de nos adhérents. Bien sûr que la présidence que je vais exercer sera dans la continuité des actions de Philippe et Sandra, l’ADN de l’UNIC doit être respecté, la défense des intérêts des petites écoles de conduites. Nous allons évoluer sur certains points, nous allons revoir certaines choses, mais avec l’équipe du conseil d’administration, nous allons garder notre identité UNIC.
Quelles sont les idées que vous allez défendre et quels sont les combats que vous allez mener pendant votre mandat ?
Les idées à défendre sont celles qui ont forgé l’UNIC. L’indépendance et la liberté sont les maitres mots, ils sont l’ADN de l’UNIC.
– L’amélioration du système de répartition des places d’examen. RDVPERMIS, une méthode novatrice dans la réservation des places, mais comme je l’ai toujours dit et comme l’ont dit mes prédécesseurs : « quelle que soit la méthode de répartition des places, tant que la production de places ne sera pas suffisante, cela ne fonctionnera pas ».
– Les mesures visant à limiter, contrer la fraude, le calcul des ETP ne sont en réalité que des mesurettes qui ne répondent pas aux vrais besoins des écoles de conduite. Nous avons besoin d’un nombre de places suffisamment élevé pour répondre aux candidats, limiter les délais d’attente et faire disparaitre le coté anxiogène du moment de la réservation des places d’examens.
– Le refus de l’UNIC de valider le discours de l’administration qui rejette la faute sur les écoles de conduite quant au taux de réussite.
Voilà pour les principales idées. Quand je dis principales, j’entends les mesures phare. Maintenant, je continuerai à porter les combats qui sont déjà en cours. Je pense au dés-encadrement des frais d’accompagnement ou, du moins, à une révision de la mesure. Des discussions sont en cours avec la DGCCRF. D’autres sujets sont en cours et nous ne manquerons pas de vous présenter ces futures actions dans un avenir proche.
Est-ce que vous avez un message à faire passer aux gérantes et aux gérants d’auto écoles qui nous lisent ?
Je les invite à prendre contact pour nous faire part de leurs questions et observations. Ils peuvent venir à notre rencontre lors du Congrès 2025 de l’UNIC les 5 et 6 décembre à Strasbourg (formulaire d’inscription à demander par mail à : contact@unic-ae.org) ou prendre contact avec nous sur notre site internet : unic-ae.org.