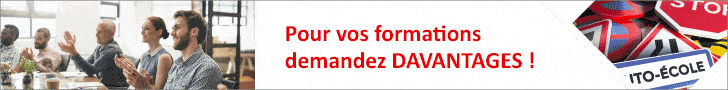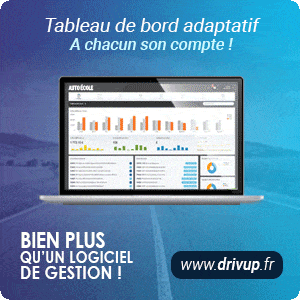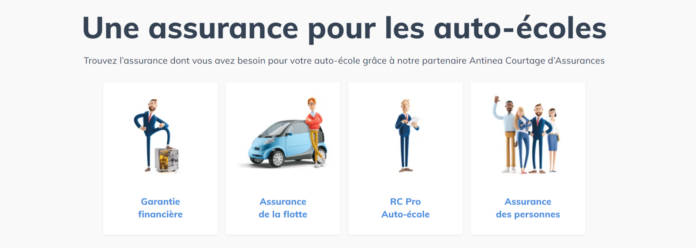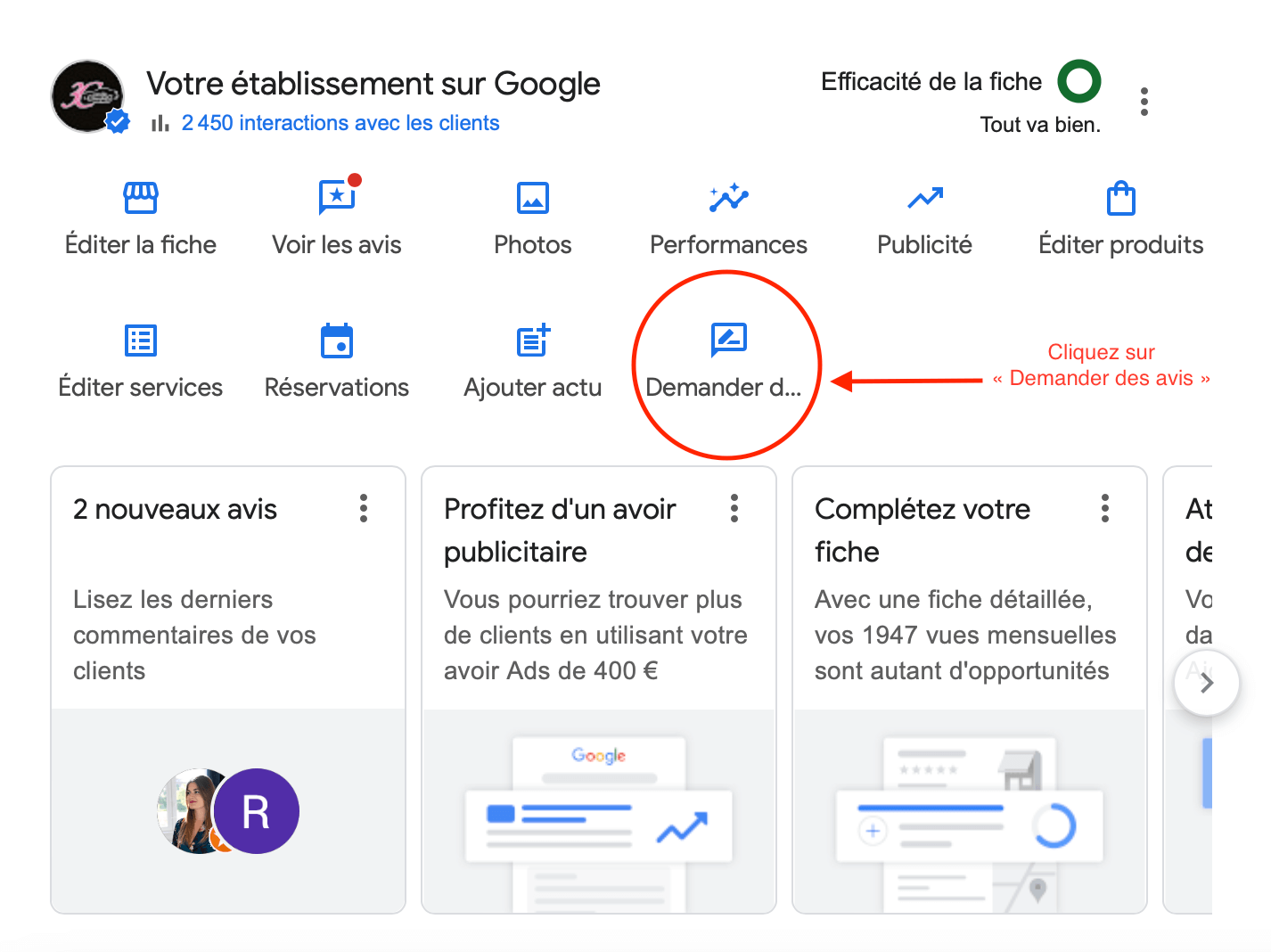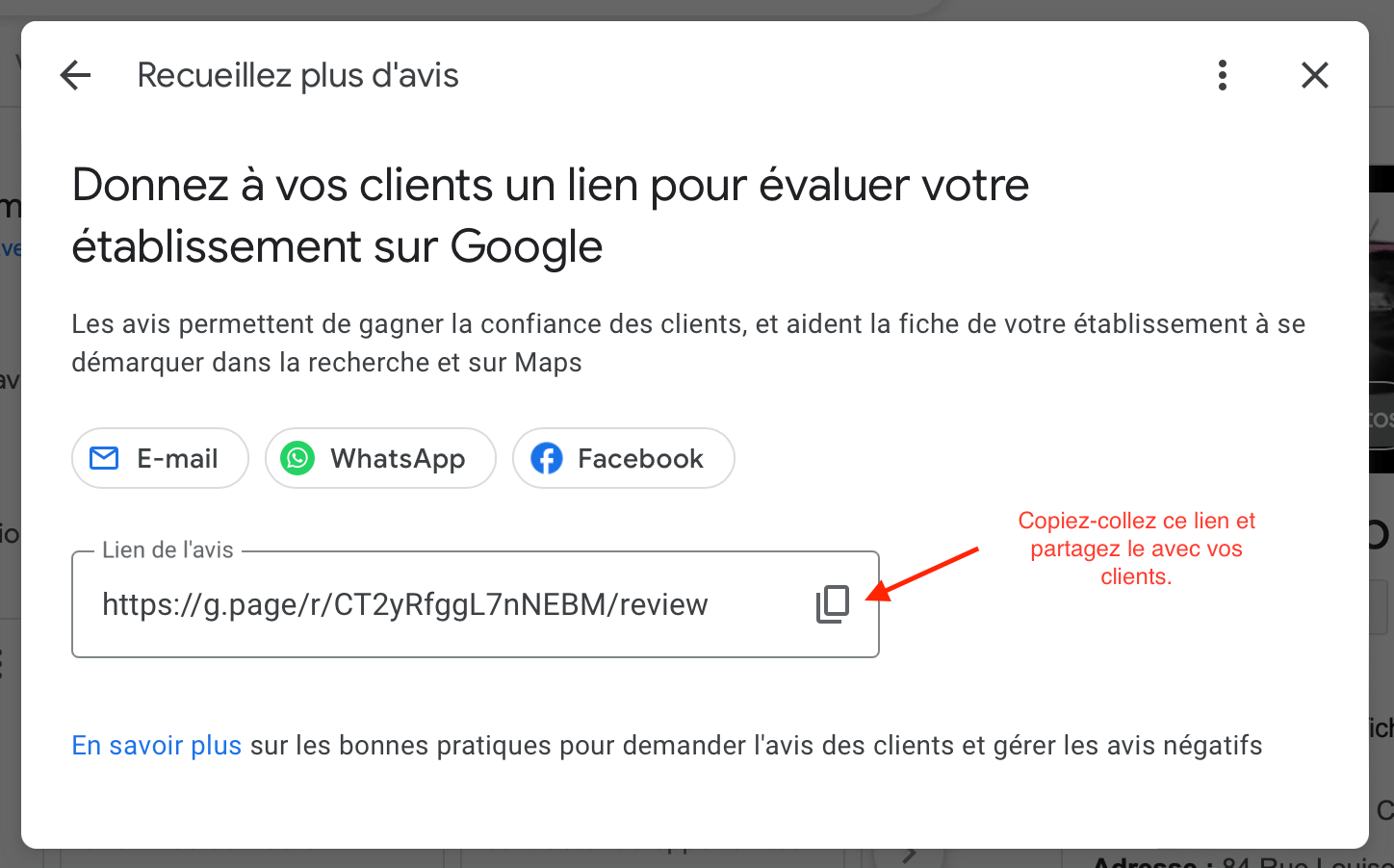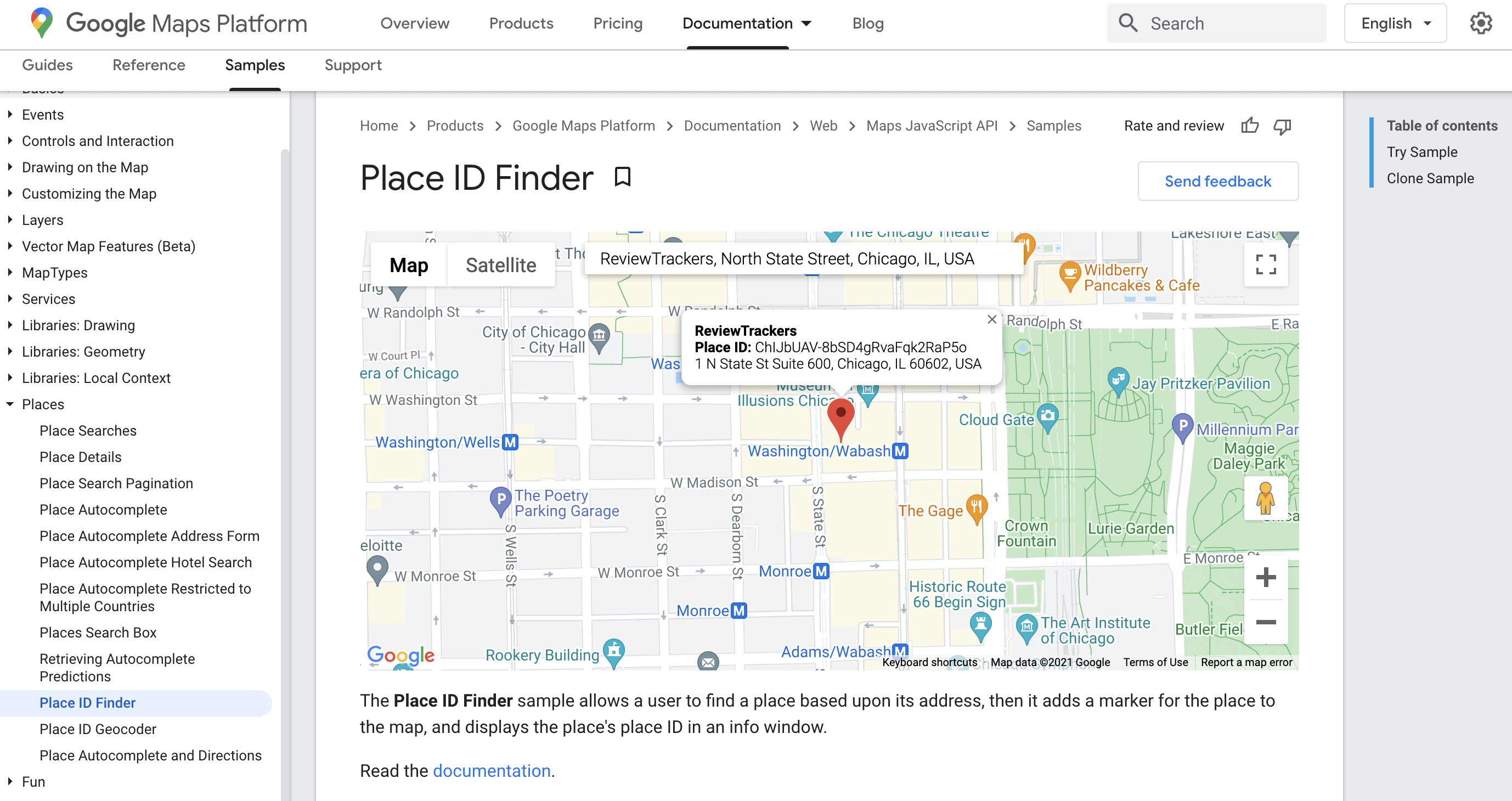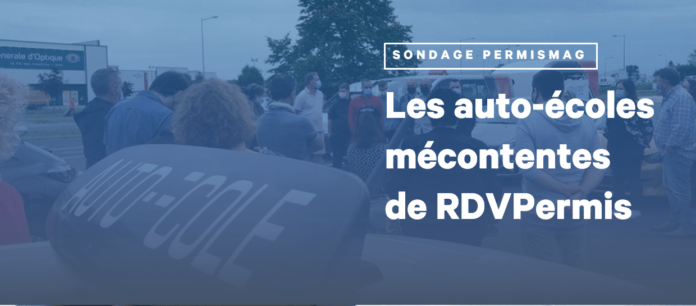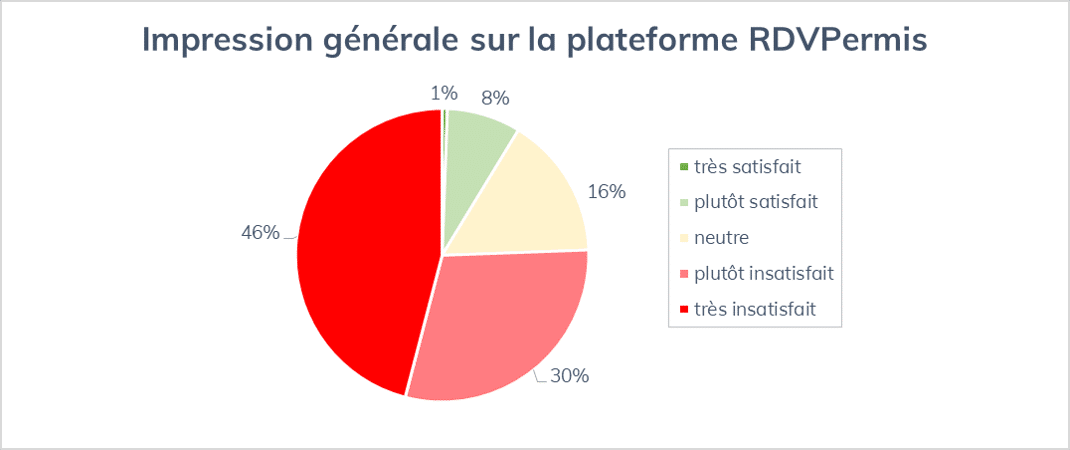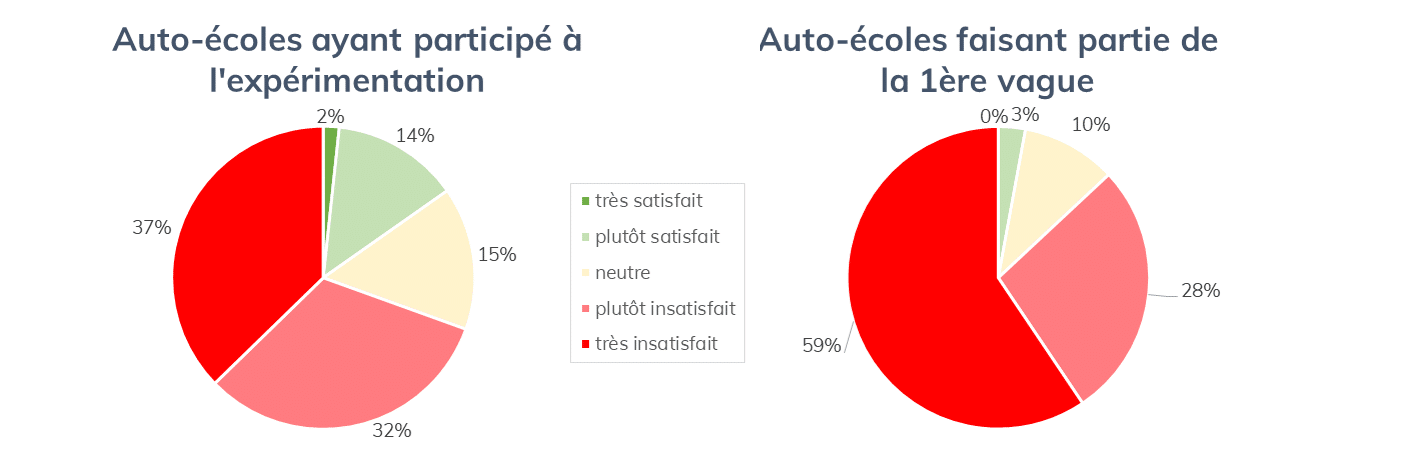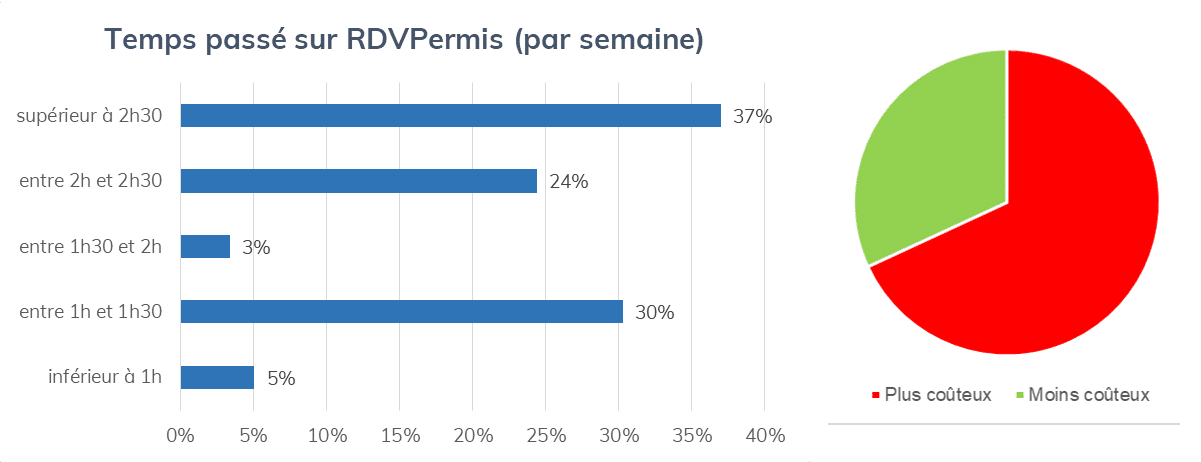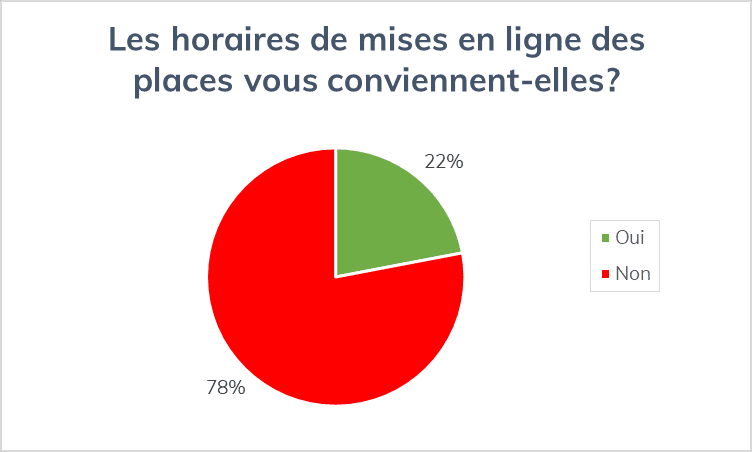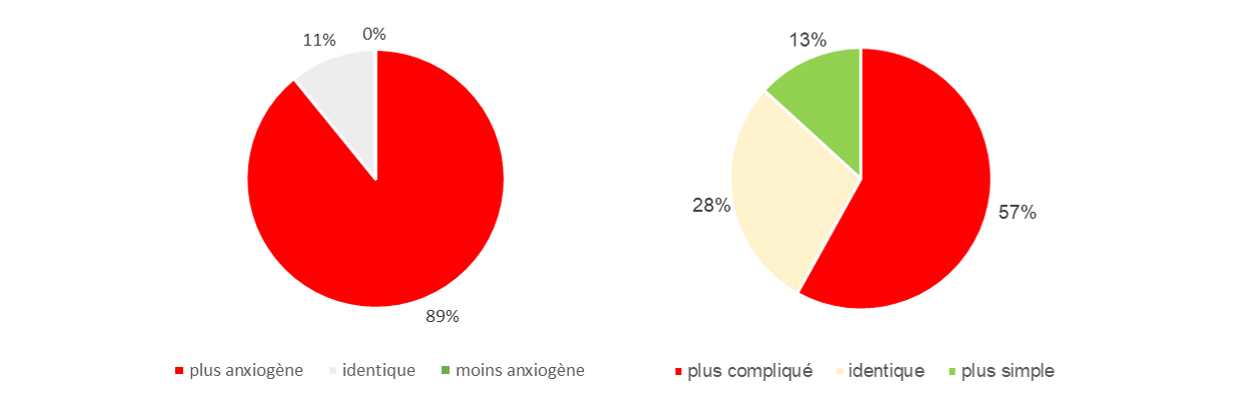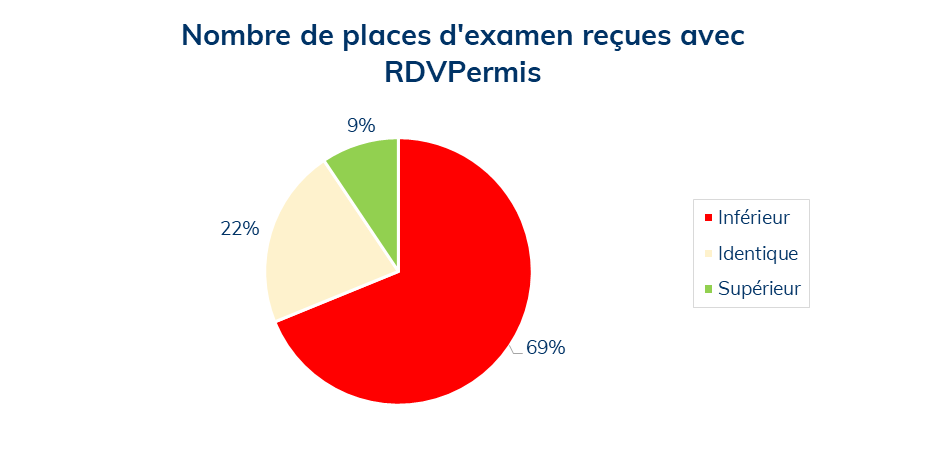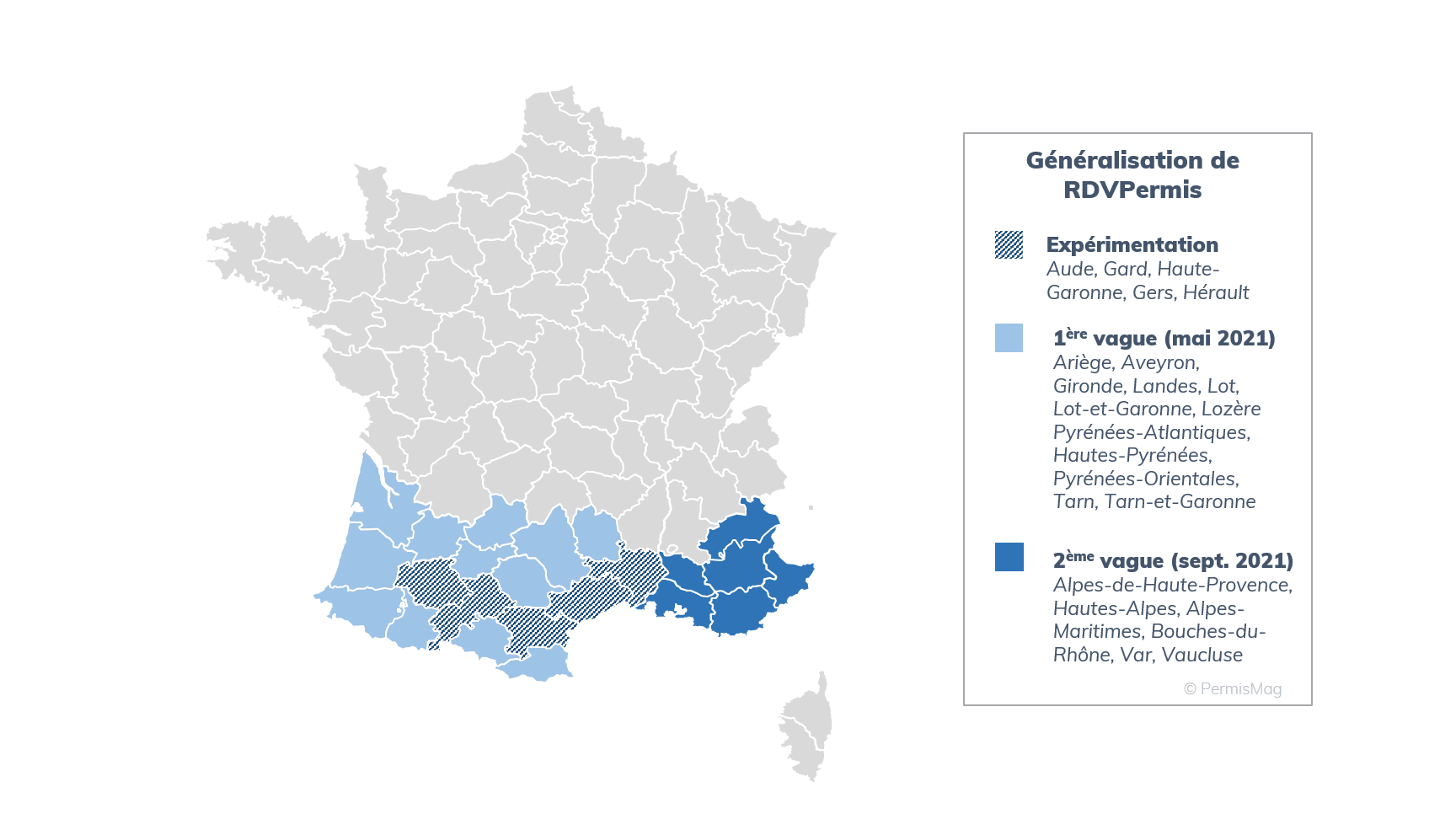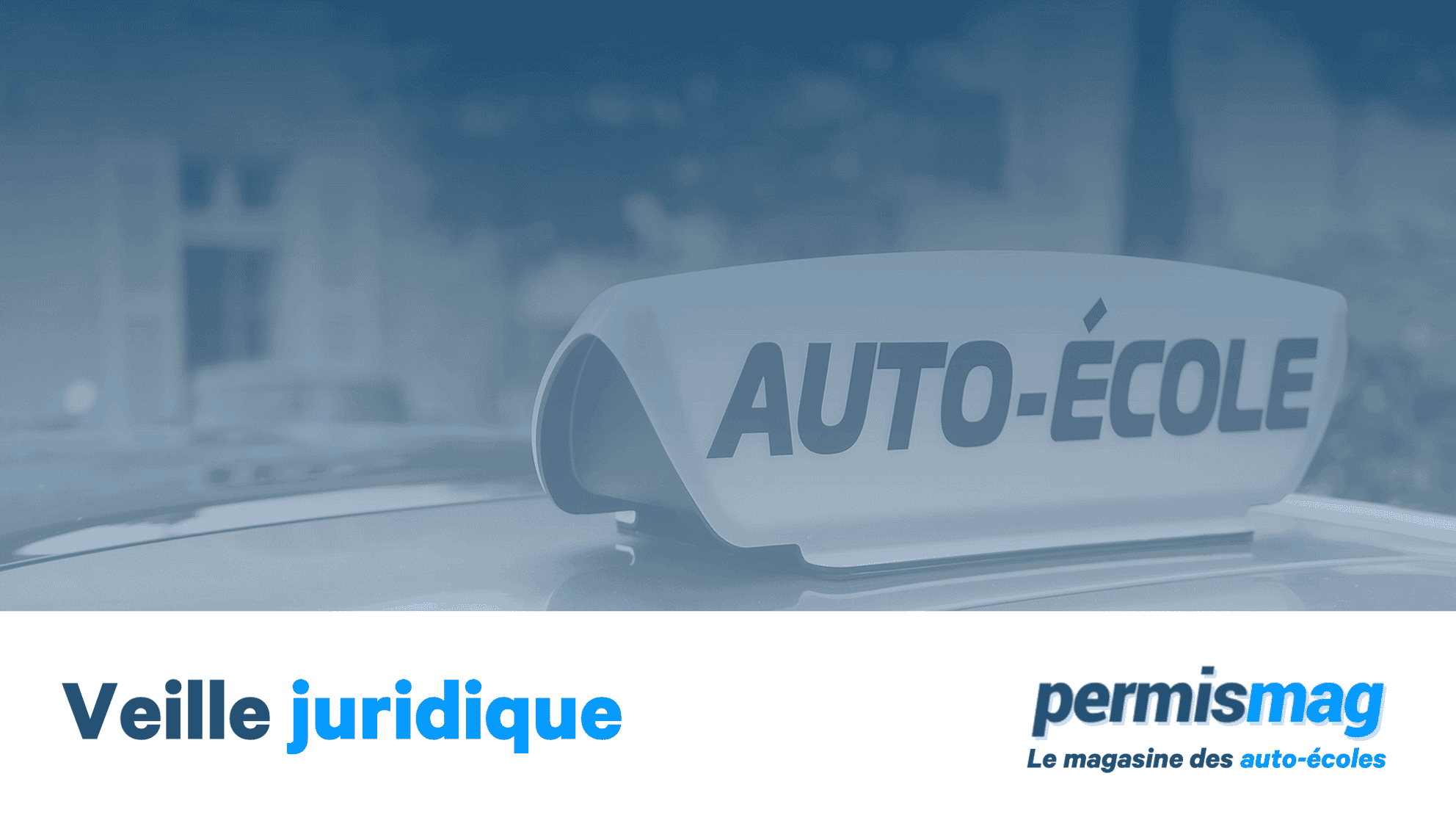Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 6 septembre 2021, le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe au titre de l’année 2022 est fixé à 29. Lire la suite
En cette rentrée 2021, VroomVroom annonce le lancement d’une gamme complète d’assurances dédiées aux auto-écoles : garantie financière, assurance de la flotte, assurances multirisques pour le local (RC Pro), assurance santé et prévoyance pour les salariés… L’offre – commercialisée en partenariat avec Antinea Conduite – se veut plus économique et doit permettre aux auto-écoles de payer moins cher leurs assurances.
Une garantie financière incontournable mais compliquée à obtenir
Le label de qualité impose aux écoles de conduite de souscrire à une garantie financière (critère 1.1) afin de protéger les élèves en cas de défaillance de l’entreprise. Cependant, dans les faits les compagnies d’assurances sont relativement « frileuses » quand il s’agit de proposer ce genre de garanties aux auto-écoles. En effet, la faible rentabilité endémique au secteur et le nombre élevé de défaillances représentent un réel risque pour les assureurs.
Les assureurs qui continuent à proposer la « garantie financière » se protègent en exigeant toujours plus de contreparties (caution personnelle, regroupement de l’ensemble des contrats d’assurance, etc…). Les structures créées récemment ainsi que celles ayant eu un exercice comptable déficitaire au cours des 3 dernières années sont de facto exclues de la garantie financière, du label et des avantages qui en découlent (formations passerelles, permis à 1€ / jour, équivalence avec la certification Qualiopi, etc…).
En l’absence d’un mécanisme de garantie financière assuré par l’État, certaines auto-écoles se retrouvent dans une impasse. Les exemples sont nombreux et parfois déroutants, telle cette auto-école familiale, créée en 1968, qui s’est vue refuser sa garantie financière à cause d’un exercice déficitaire de 1 000€ il y a 2 ans… alors même qu’elle est redevenue bénéficiaire l’an passé.
Pour Nicolas Grumberg, le directeur de VroomVroom.fr « l’accès à la garantie financière présente une vraie difficulté. Nous avons souhaité répondre à ce problème avec notre partenaire Antinea Courtage et aller plus loin en proposant une gamme complète d’assurances pour les écoles de conduite. »
Une offre globale et sans contrepartie
L’offre mise en place par VroomVroom ne s’arrête pas à la garantie financière, elle répond à l’ensemble des besoins de l’école de conduite en matière d’assurance, à savoir une assurance santé et prévoyance (mutuelle) pour les salariés, une assurance multirisques (RC Pro) pour protéger le local en cas d’incendie, de dégât des eaux ou en cas d’accident corporel à l’intérieur du local et enfin une assurance de la flotte pour couvrir le ou les véhicules à double commandes.
L’auto-école qui souhaite n’avoir qu’un seul interlocuteur pour ses contrats d’assurance a la possibilité de les regrouper mais ce n’est ni un prérequis ni une obligation. Chacune de ses offres peut être souscrite indépendamment.
Pour Quentin Ginet, directeur général d’Antinea Courtage, « notre offre se veut simple et flexible. La plupart des auto-écoles sont déjà assurées. Nous pouvons leur proposer de regrouper leurs différents contrats d’assurance afin de n’avoir qu’un seul interlocuteur… mais ce n’est absolument pas quelque chose que nous imposons. Le maître-mot est la liberté. »
Permettre aux auto-écoles de payer moins cher leurs assurances
L’autre objectif mis en avant par VroomVroom et Antinea est d’aider les auto-écoles à faire des économies en payant moins cher leurs assurances. Pour Quentin Ginet, « les assurances représentent un poste de dépense non-négligeable pour les auto-écoles et ces coûts peuvent être réduits, sans toucher au niveau des garanties proposées. Ils peuvent l’être sur la garantie financière mais également sur l’assurance de la flotte sur laquelle nous sommes compétitifs. »